Une partie du voyage plutôt improvisée. Nous nous sommes arrêtés à des endroits qui nous ont été conseillés par d’autres voyageurs.
Bundaberg
De Cairns, nous prenons la direction du sud. Nous longeons la côte et effectuons notre premier arrêt à Bundaberg pour des raisons, disons, très éclectiques: les tortues et le rhum.
Nous sommes en effet dans la région de la canne à sucre. L’Australie possède une industrie sucrière, un peu en recul, soit dit en passant. Le sucre de canne, comment ça marche? Le principe est d’écraser la canne à sucre pour en extraire le jus. Le jus est porté à haute température. Une partie se cristallise: le sucre. Le sirop qui reste est appelé mélasse. A la fin du XIXe siècle, la région est en surproduction et on ne sait pas quoi faire des quantités colossales de mélasse. Un producteur propose alors de transformer cette mélasse en rhum.
Après quelques années de tâtonnements, deux incendies catastrophiques, plusieurs inondations destructrices et la réquisition de l’intégralité des stocks par le gouvernement australien pour les besoins des soldats des première puis deuxième guerres mondiales, la distillerie est toujours là et produit un rhum de dégustation très apprécié. Son symbole: un ours polaire…
On visite donc la distillerie, temporairement dépossédés de nos appareils photos, clés de voiture et même de nos montres. Dans certains bâtiments, le taux d’alcool dans l’air est si élevé qu’il est strictement interdit d’amener quoi que ce soit qui puisse créer une étincelle. Tout ce qui contient une pile nous est confisqué.
Nous passons par le bâtiment de stockage de la mélasse: une piscine de 5 millions de litres d’un épais sirop brun. Nous jetons un coup d’oeil rapide aux cuves en inox où la mélasse est distillée plusieurs fois: on passe du sucre à l’alcool. Puis nous entrons dans le saint des saints: l’entrepôt où l’alcool fermente dans d’immense cuves de pin américain. La qualité du rhum dépend essentiellement du temps passé dans ces cuves qui colorent l’alcool de canne grâce aux tanins contenus dans son bois. La distillerie de Bundaberg est, dans ce domaine, particulièrement innovante: elle expérimente la fermentation du rhum dans d’anciennes cuves ayant servi pour le vieillissement de whiskys de légende, de cognacs fameux, de vins rouges d’exception… Les barils viennent de France, d’Ecosse, d’Espagne… Les résultats sont surprenants. Le rhum obtenu présente de belles nuances de couleurs allant du grenat à l’ambre. Le goût est au rendez-vous: le rhum vieilli en fût écossais a reçu plusieurs récompenses à des concours internationaux.
Nous terminons notre visite au bar pour déguster les produits: rhum épicé, liqueur rhum chocolat, rhum de 10 ans d’âge… Il est 14h00, on est à jeun, il fait chaud. Là, sur les bancs de style victorien installés sur la terrasse d’une maison qui évoque les habitations de Louisiane, nous nous laissons doucement glisser, le sourire aux lèvres, vers un délicieux état second…
Le soir, nous nous rendons au bâtiment des rangers de la plage de Mon Repos. Cette plage longue d’un kilomètre et demi a la particularité d’accueillir, de décembre à avril, les tortues marines. Cet endroit est unique au monde. Les tortues guidées par leur instinct reviennent chaque année y pondre des centaines d’oeufs.
De nuit, elles sortent péniblement de l’eau, se hissent sur la plage en laissant derrière elles de caractéristiques empreintes de roues de tracteur. Arrivées en haut de la plage, à un endroit où le sable a la consistance correcte pour créer une chambre susceptible d’accueillir l’abondante couvée, la tortue creuse, méthodiquement un trou avec ses deux pattes arrières.
Elle met une bonne demi-heure pour y lâcher sa centaine de cocos. Ensuite, elle enterre ses oeufs et redescend lourdement la plage, trainant sa centaine de kilos sur le sable. Une fois les premières vagues atteintes, elle retrouve sa dextérité et hop, elle disparait dans le Pacifique. Elle reviendra certainement pondre de nouveau dans quelques jours ou quelques semaines. Puis, elle disparaitra pendant plusieurs années avant de revenir sur même plage. Le spécimen que vous voyez sur la photographie n’était pas revenu depuis 6 ans. C’est le numéro d’immatriculation gravé sur la bague placée sur sa nageoire qui en atteste.
Six semaines plus tard, les petites tortues s’extraient de leur nid. Nous avons la chance d’assister au spectacle de la sortie de la chambre d’incubation. Attirées par le reflet de la lune sur la mer, les petites tortues se lancent dans une cavalcade effrénée vers l’eau. Une course pour la vie. Elles dévalent à toute allure la plage pour atteindre le plus vite possible le ressac. Sur la plage, elles sont vulnérables, même si leur instinct leur commande de sortir du sable de nuit pour échapper aux oiseaux et aux crabes voraces. Le ranger se saisit d’un bébé tortue pour que nous puissions en voir un de plus près. Elle ne cesse pas d’agiter les nageoires. Ca pagaie, ça pagaie comme un lapin Duracell.
Pendant trois jours, cette programmation génétique remontant des temps préhistoriques lui permettra de gagner les courants du Pacifique qui la conduiront vers les zones de nourrissage. Trois jours, soit l’énergie contenue dans le jaune d’oeuf qu’elle a absorbé juste avant l’éclosion.
Une fois la mer atteinte, les petites tortues disparaissent. Impressionnant de constater comment la nage leur parait si naturelle alors qu’elles sont nées sur terre.
Malheureusement, le voyage dans le Pacifique est semé d’embuches. Des milliers de petites tortues qui arrivent dans la mer, cela constitue un formidable festin pour tout un tas de prédateurs. Sans parler des déchets humains qui les emprisonnent, des filets de pêche qui les noient et des moteurs de bateaux qui les blessent. Le ranger nous raconte que seule une tortue sur mille atteindra l’âge adulte.
On ne connait pas grand chose des tortues marines. Et l’essentiel de ce que l’on sait, on le doit aux dizaine d’années de collecte d’informations par les rangers qui travaillent à la plage de Mon Repos. Les tortues pondent ici. Elles atteignent en trois jours les courants du Pacifique. Ensuite, elles disparaissent pendant une trentaine d’années. On ignore complètement ce qu’elles font pendant cette période que les scientifiques ont d’ailleurs appelées “lost years”. Elles reviennent après 30 ans pour pondre à l’endroit où elles sont nées. On a commencé à s’intéresser aux tortues marines dans les années 50, juste après avoir constaté la baisse drastique de leurs effectifs. En somme, presque trop tard. Les scientifiques ont commencé à baguer les tortues de Mon Repos pour connaitre leur rythme de ponte. Sur la carapace de plusieurs d’entre elles, ils ont placé des systèmes de traçage pour connaitre leurs déplacements. Depuis, ils enregistrent et compilent les données.
En attendant d’en connaitre plus, leur priorité absolue est de préserver la plage de Mon Repos et le calme des eaux environnantes pour que les tortues puissent revenir pondre en toute quiétude. Après des années de lutte, de sensibilisation, de levées de fonds et de lobbying, ils ont réussi à obtenir de l’état du Queensland l’interdiction de pêcher pendant la période de ponte et d’éclosion au large de mon Repos, créant ainsi un couloir sécurisé pour les tortues. Ils ont aussi obtenu l’interdiction de construire sur le littoral en face de la plage, coupant l’herbe sous le pied des promoteurs rapaces.
Depuis quelques années, la baisse des effectifs s’est stabilisée. Mais rien n’est gagné. Les scientifiques estiment qu’une baisse de 5% du nombre de naissance causerait la disparition définitive des tortues marines.
Byron Bay
Nous nous rendons à Byron Bay après avoir lu un commentaire intéressant et non dénué d’humour sur Trip Advisor. Un type recommande chaudement la visite pour Julian’s Rock, un spot de plongée où on peut voir du gros. Par là on entend des dauphins, des raies, des requins-léopards, des tortues…
Byron Bay est à la croisée de deux courants marins: l’un chaud venu du nord et l’autre froid venu du sud, qui attirent une grande diversité de faune sous-marine. Nous nous rendons directement au centre de plongée pour réserver une place sur un bateau. Ce matin, Roger, le capitaine de l’embarcation qui nous emmène sur le site, lutte contre une forte houle. Les vagues font entre 3 et 4 mètres. Mon petit-déjeuner fait les montagnes russes.
Une troupe de dauphins nous accompagne pendant quelques dizaines de mètres avant de prendre une autre direction. Vision enchanteresse ! Nous arrivons le coeur sur la main sur le site de plongée de Julian’s Rock. Sur ce type de bateau pneumatique, la mise à l’eau se fait en se laissant tomber en arrière. Nous devons immédiatement lutter contre le courant de surface pour atteindre la chaine d’ancrage. Sous l’eau c’est encore pire. Nous devons rester le plus proche possible du plancher pour ne pas nous faire emporter. Pour le reste, le paysage sous-marin est fascinant. Le “gros” est au rendez-vous. Un requin-léopard (inoffensif, on vous rassure) croise à quelques mètres de nous.
Des Kingfishes chassent à quelques coups de palme de là. En se laissant porter par le courant, on aperçoit une tortue marine qui nous accompagnera jusqu’à la fin de la plongée.
Julian’s Rock est aussi une station de nettoyage…pour raies. Elles viennent ici pour se faire faire enlever des parasites par tout un tas de poissons laveurs. Un vrai fish spa. Nous croisons des requins en camouflage militaire qui broutent les algues marines. La visibilité est d’une vingtaine de mètres. L’endroit est très impressionnant.
Le problème c’est qu’en se battant contre le courant, on consomme notre oxygène très rapidement. La bouteille de Nicolas est presque vide. Il me fait signe sous l’eau qu’il va bientôt utiliser mon régulateur de secours. Traduction: pomper mon air. Poussés par la menace de la bouteille vide, nous remontons. La tortue marine nous fait ses adieux en venant respirer juste à coté du bateau.
Byron Bay est aussi un repère de surfeurs. La ville est pleine de magasins où le surfeur se réapprovisionne en vêtements fun et bigarrés, en fart et en planches de surf super cool. Quiksilver, Rip Curl, Billabong, il y a l’embarras du choix mais pas pour toutes les bourses. Le T-shirt Billabong c’est 40€ minimum.
Des écoles proposent des cours de surf. Nous observons les apprentis surfeurs. Descente de la plage avec la planche en courant, on s’agenouille sur le surf et on pagaie avec les bras, virage et retour avec les vagues sur la plage… et on recommence, une bonne dizaine de fois pour gagner en assurance et en stabilité. A les regarder, on est déjà épuisés. Puis il y a les surfeurs professionnels, ceux qui viennent tous les jours pour taquiner la vague. A ce spot situé sur le bout de la plage, on croise hommes et femmes, toutes générations confondues. Il y a tellement de monde qui attend la vague que l’endroit est dangereux. En fait, la manoeuvre consiste à slalomer entre les gens.
Miraculeusement, les surfeurs expérimentés se frayent, à coup de déhanchement, un chemin jusqu’à ce que la vague mourante se referme sur eux dans un gros bouillon.
Nicolas réalise des clichés de ces “clichés“ de l’Australie version cool. Dans la lumière de fin de journée, les profils de superbes filles en bikini ou de beaux mâles ruisselant d’eau de mer, planche sous le bras, suscitent le clic-clac Canon. On vous laisse en profiter.
Lors de notre voyage le long de la côte, nous passerons aussi par :
Brisbane
qui nous a un peu déçus par son côté aseptisé.
Les Glass House Mountains
un lieu planté de montagnes sacrées pour les Aborigènes
Et tout plein d’aires de repos dans lesquelles nous avons pu approcher un cortège de bêtes plus ou moins sauvages: kookaburras inquisiteurs, iguanes réclameurs, grenouille barbotante, possum fée du logis, galahs bruyants et marrants, perroquets colorés, serpents slalomeurs et poseurs. Reportez-vous à l’article sur le bestiaire australien.
Sydney
Nous regagnons enfin Sydney. André nous prête de nouveau son appartement. Nous le voyons malheureusement en coup de vent. Entre une arrivée de Canberra à 22h00 et un passage à l’aéroport pour aller chercher Katie qui revient de Melbourne.
Nous quittons Sydney par les airs. Pour atteindre Bangkok, nous survolons le désert australien que nous avons traversé en voiture: le bel Outback rouge.














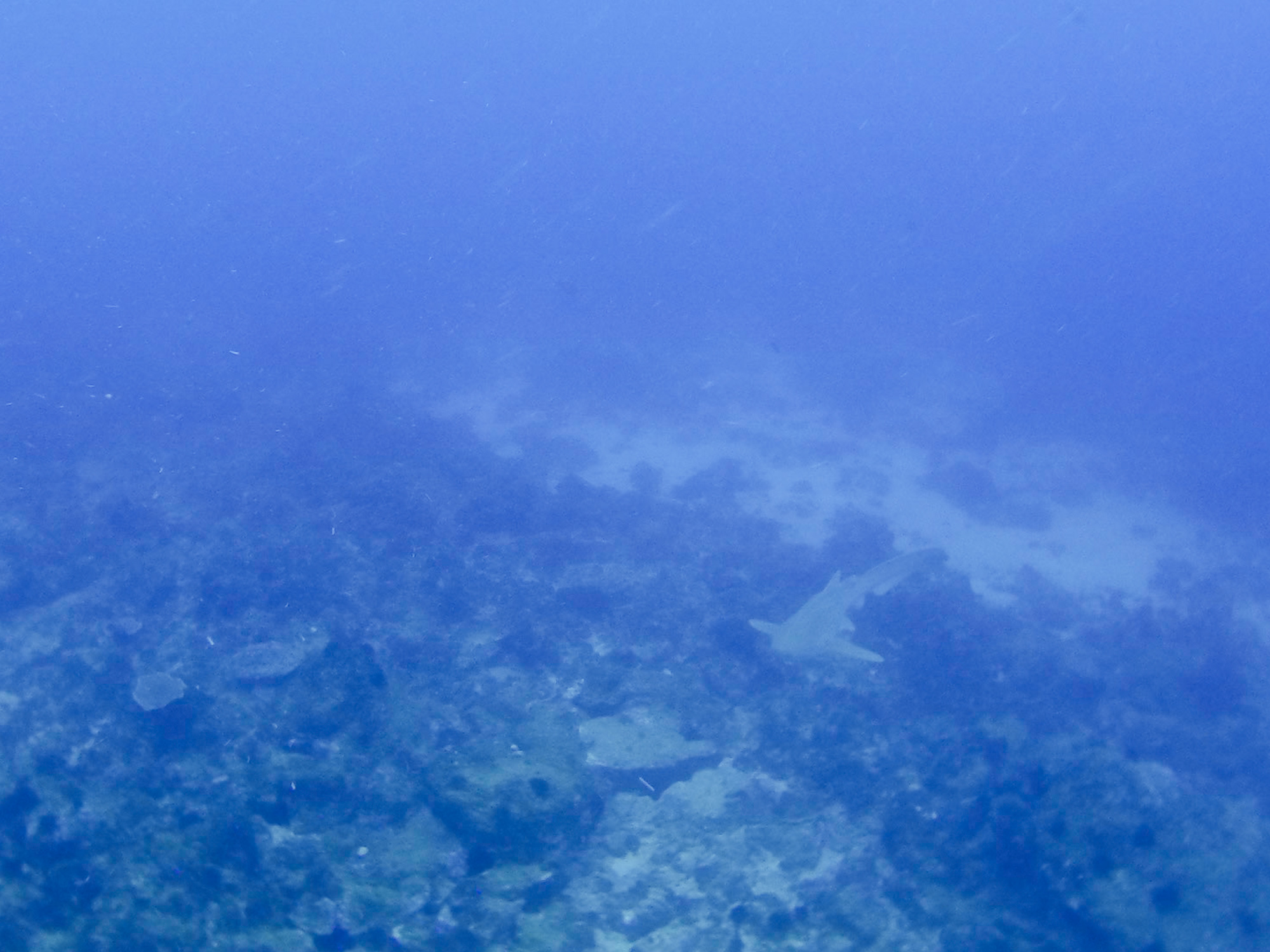








Comments powered by CComment